Francophonie et AES : pourquoi le Niger, le Mali et le Burkina Faso tournent la page ?
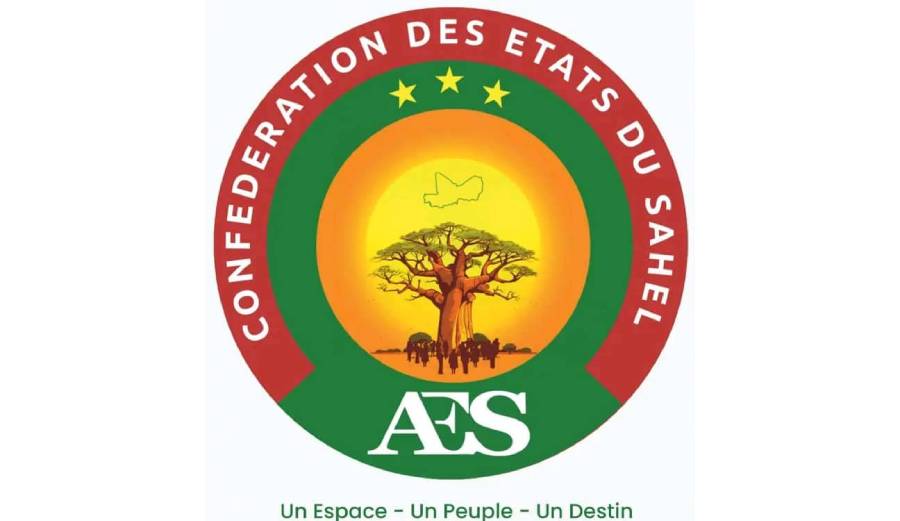 GÉOPOLITIQUE AES : que reste-il après reniement de la Francophonie ?
GÉOPOLITIQUE AES : que reste-il après reniement de la Francophonie ?
Il y a quelques jours, presque concomitamment, les trois pays de l’AES – le Niger, le Mali et le Burkina Faso – décidaient de se retirer de la Francophonie, comme ilsa le décodaient pour la CEDEAO qu’ils ont fini par quitter malgré tout un branle-bas qui tentait vainement de les y ramener. Cette dernière annonce avait surpris même si pour beaucoup d’analystes, cela était pourtant prévisible quand on sait que cette autre organisation est allée audelà de ses principes pour ne servir que d’instrument de coercition au service de la France et de son impérialisme. Elle n’avait pas su regarder pour comprendre que ces pays qui décidaient de partir d’une organisation régionale avec laquelle des liens historiques et culturels fondés sur une géographie partagée qui sous-tend des intérêts partagés, ne pouvaient pas être gênés de partir d’une organisation lointaine, scellée officiellement sur le partage d’une langue du fait d’une histoire douloureuse, et sournoisement comme instrument d’influence pour perpétuer la domination française, notamment sur les anciennes colonies libérées ( ?), oublieux des solidarités auxquelles elle appelle.
On se souvient que, suite aux malentendus avec Paris, par rapport à la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, Kigali avait été amenée à prendre la décision historique de rompre avec la langue française, et conséquemment, de quitter la Francophonie pour faire le choix de l’anglais, la langue d’un autre colonisateur, même si les deux pourraient ne pas avoir les mêmes réputations. Aussi, se demande-ton, à juste titre, si les trois pays de l’AES vont se lancer sur la même trajectoire, à savoir abandonner la langue française au profit d’une autre. Pour l’instant, on n’a aucune réponse à une telle préoccupation, entendu qu’il serait aberrant de quitter une langue coloniale pour une autre lorsque l’on ne peut pas faire la promotion d’une langue africaine quelconque ayant une certaine dimension pour être partagée dans la géographie de l’AES. C’est pourquoi, il faudrait, sur un tel sujet, se donner plus de temps pour réfléchir pour nous débarrasser de certains complexes et comprendre qu’une langue n’est la propriété de personne, et la France aura beau aimer faire du français un patrimoine français, elle s’est rendue compte, depuis qu’elle l’a laissée aller en aventure dans le monde pour aller à la rencontre d’autres cultures, d’autres peuples et d’autres langues qu’elle lui est revenue sur différents visages, métissée. Elle sait depuis que « sa » langue n’est plus la sienne quand des cultures diverses, des peuples et des langues plurielles l’ont contaminée pour la lui rendre métisse pour refléter des parlers divers, tout aussi riches. Son français est ainsi dominé par d’autres peuples qui ont appris à la parler. Les questions des langues sont donc des questions délicates car les langues se créent, vivent, se transforment et souvent meurent. Sur le continent, nous avons mis notre génie dans la langue française pour lui apporter des fraîcheurs nouvelles et des parfums exquis réinventés qui en font toutes ses subtilités et lui donnent toutes ces résonances lointaines, merveilleuses. Si nous avons à faire des choix nouveaux, encore faut-il que ce soit les meilleurs…
Une décision qui vient corser l’amertume de la France piégée
La France, par manque de vision de la part de son président, Emmanuel Macron, est tombée dans son propre piège. Lorsque l’annonce du retrait des pays de l’AES, et d’abord du Niger, pays fondateur de la Francophonie, est faite, l’establishment français est atterré, croyant dans un premier temps qu’il ne s’agit que du Niger pour finalement comprendre l’ampleur du désastre quand, les deux autres pays vont lui emboîter le pas, annonçant leur sortie de la Francophonie. Pourtant, ce n’était que logique. Quand la Francophonie peut se réunir tout en choisissant de ne pas inviter à un sommet des pays membres sanctions pour des choix souverains, et notamment ceux de l’AES, croyant trouver là le moyen de contrarier ces pays dans leurs choix, alors que rien ne peut légitimer une telle attitude paternaliste de l’OIF visà- vis de ces pays, alors l’ont n’aura compris, comme dans le cas de la CEDEAO, que ces institutions sont corrompues, détournées de leurs missions originelles, pour ne servir désormais que les intérêts d’une France coloniale qui ne sait plus jouer son époque. Plus que d’être le signe d’un rejet d’un passé colonial, le départ de la Francophonie est l’expression d’un malaise qui a ses sources dans le type de relations que la France a entretenues avec le continent sans y laisser quelque place à la souveraineté des Etats indépendants se donnant à la fois un droit et un devoir de maternage sur ces pays, jusqu’à s’ériger en grande électrice pour ces pays en décidant de qui devra, dans nos démocraties manipulées, les gouverner, ce au moyen d’élections truquées.
La décision de l’AES de partir de la Francophonie gène et la France semble être prise au dépourvu
Les réactions en France, et notamment de la porte-parole de l’OIF sur France 24 en disent long sur les malaises. Il est dommage que la Francophonie, conformément à sa charte signée à Bamako, dans le but de prévenir les crises qu’on voyait pourtant venir, n’ait pas eu le courage d’interpeller les pouvoirs en place dont les gestions avaient pourtant été décriées avec nombre de scandales mis à nu mais que la France a daigné entendre, laissant ses sous-préfets terroriser la démocratie, malmenant les libertés, les textes et les adversaires politiques, pour jusque qu’on en arrive là, avec encore, une France qui refuse d’ouvrir les yeux et de voir le désastre de démocraties amputées, violentées. Tous les observateurs sont assez lucides à comprendre que par l’érosion de l’espace francophone, du fait de ces départs, la France perd de l’influence et pas que ; elle perd bien d’intérêts sur le continent, intérêts sur lesquels repose ses projets d’avenir, tous ses espoirs pour sauvegarder, au milieu de l’Europe, sa puissance aujourd’hui mise à rude épreuve avec une économie en déliquescence, totalement ruinée, comme l’est sa réputation dans son ancien empire.
Christine Dessouches, ancienne Conseillère Spéciale du Secrétaire Générale de l’OIF, autrice de l’ouvrage De La Francophonie, intervenant elle aussi sur France 24 comme pour montrer que le sujet préoccupe, ne peut cacher sa déception de voir la Francophonie, cette belle chose dessinée par des Africains visionnaires qui se rétrécie aujourd’hui comme peau de chagrin, ne devenant que l’ombre d’elle-même quand les hommes chargés de la gouverner ne peuvent incarner son leadership. « Je ne suis pas surprise mais je suis triste ; je crois que le moment est grave parce qu’il ne s’agit pas de n’importe quel pays », plaint-elle.
Il ne faut pas oublier que c’est au pays de Hamani Diori, sur les bords du fleuve Niger, qu’avait été signée la charte de ce qui deviendra la Francophonie – l’ACCT, l’Agence de Coopération Culturelle et Technique – et on comprend que le départ d’un tel pays ampute à l’organisation internationale tout un pan de son histoire et notamment de ceux qui, par leur intelligence, avaient pensé et donné corps et âme à la géopolitique de la langue française, avant que la France, elle-même n’y pense et ne la détourne de ses fondations pour ses seules fins.
Regrettant sans doute qu’ « Il y avait des signes avant-coureurs » qui auraient pu aider à éviter qu’on en arrive là, elle laisse échapper sa déconvenue qu’elle partage sans doute avec beaucoup d’autres milieux francophiles. Dans un monde décentré, la France a à faire attention aux mutations du monde pour savoir prendre sa place et conserver des relations qui ne peuvent plus tenir avec ses anciennes pratiques.
Ainsi, la belle fleur de la diversité s’est fanée…
Korombeyzé (Le Canard en furie)

