Monnaies nationales et émergence de classes moyennes rurales dans les pays de l’AES : une perspective de transformation économique et sociale - Par Ali ZADA
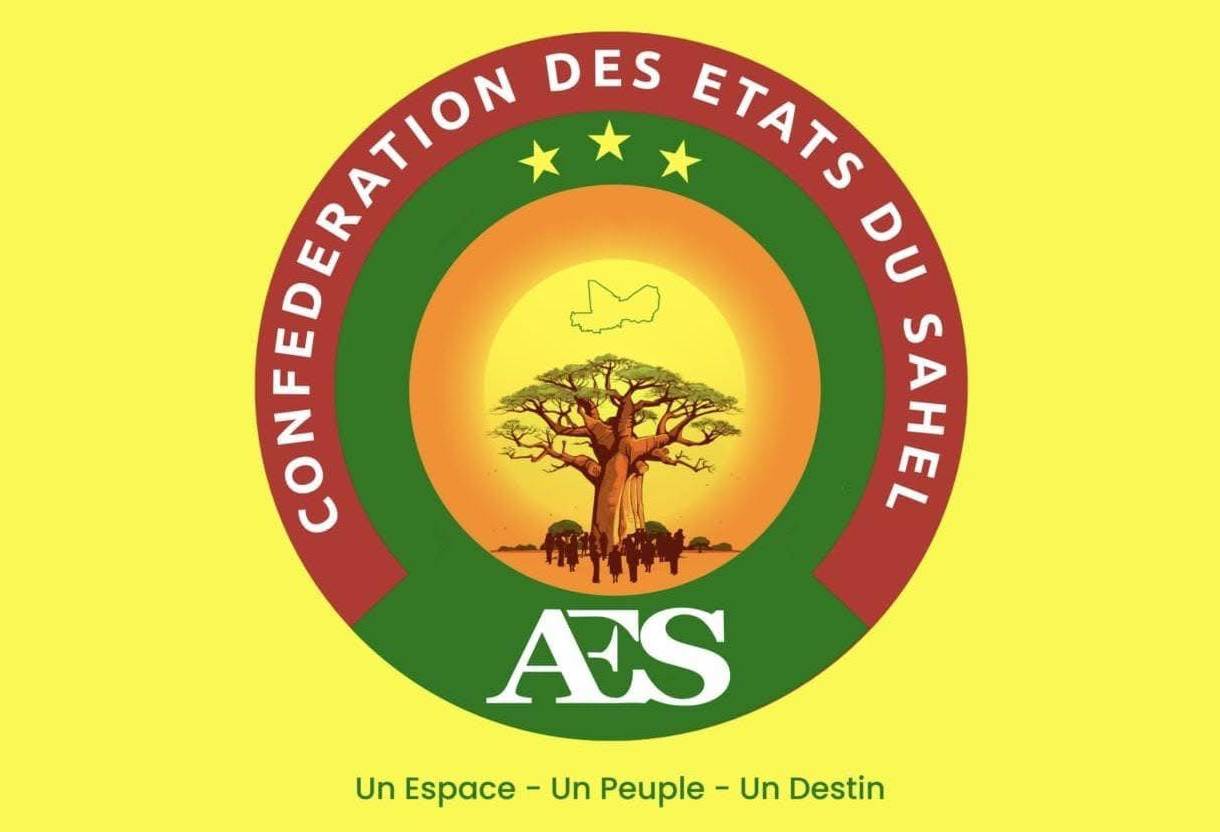 La monnaie est pour la transformation économique et sociale le sang qui irrigue le corps. Non une fin en elle-même, elle a pour rôle d’apporter les nutriments qui aident les secteurs d’activités à se développer et offrir aux couches sociales la possibilité de s’enrichir par le travail.
La monnaie est pour la transformation économique et sociale le sang qui irrigue le corps. Non une fin en elle-même, elle a pour rôle d’apporter les nutriments qui aident les secteurs d’activités à se développer et offrir aux couches sociales la possibilité de s’enrichir par le travail.
Je parle bien évidemment d’une monnaie nationale souverainiste, au service des peuples, telle que je la conçois distinctement pour chaque pays de l’AES. Je parle évidemment d’une monnaie souverainiste ayant pour rôle de promouvoir l’agriculture et l’industrie et non d’une monnaie libérale destinée simplement à soutenir des échanges commerciaux. Que dis-je, je rêve d’une monnaie n’ayant rien de commun avec le FCFA, de par sa mission de principal créateur de richesse et son dispositif institutionnel public orienté vers le crédit universel aux ménages et aux entreprises.
Dans un récent article intitulé « De l’épineuse question de la réforme monétaire dans la Confédération des Etats du Sahel », je mettais en garde nos experts nationaux en charge de réfléchir sur la réforme monétaire, d’emprisonner les peuples de l’AES d’une part dans une monnaie commune auto-répressive, sans efficacité dans la promotion du développement économique et social, parce que incapable de créer de la richesse, et d’autre part ingérable à trois compte tenu des énormes défis sociaux et économiques que les Etats doivent individuellement relever, chacun y allant de ses réalités avant de pouvoir mettre les acquis et les expériences ensemble, dans un nouveau cadre fédéral. Pour être souveraine, une monnaie se doit d’être nationale. Je le répète !
Ceux qui comprennent quelque chose aux monnaies nationales savent qu’un gouverneur d’une banque centrale est, après le chef des services de renseignement, la deuxième personnalité avec laquelle le président de la république s’entretient le matin, avant même de prendre son café.
De par sa fonction et les chiffres qu’il détient, le gouverneur de la banque centrale décide d’injecter de la monnaie ou de fermer le robinet, accorder le crédit aux entreprises et aux ménages et les crédits pour la campagne agricole à venir ou les refuser, hausser ou baisser le taux directeur qui a des répercussions instantanées sur la demande nationale de crédit, stabiliser le taux de change pour stabiliser l’économie, concéder de la monnaie vide au Trésor public pour des investissements publics et des urgences ou d’estimer que l’institution en fait trop déjà, utiliser les réserves de devises pour telles ou telles importations, réguler l’inflation ou la laisser ronger le pouvoir d’achat, calmer la rue ou la chauffer en accordant ou en refusant la subvention de l’Etat à certaines denrées, etc. Et surtout quand les étudiants et les syndicats sont dans la rue pour leurs « intérêts matériels et moraux », c’est le gouverneur de la banque centrale qui doit juger de l’opportunité d’injecter ou non de la monnaie pour faire face à la situation.
Dans la gestion de tous ces tracas, pendant que le président de la république voit des urgences et des arguments pour sa campagne électorale, le gouverneur de la banque centrale a les yeux rivés sur des indicateurs. Il ne faut pas plus pour que le président de la république soupçonne le gouverneur de la banque centrale de chercher sa place en fomentant des troubles sociaux. Comme le patron d’une entreprise et son comptable, les deux personnages de s'apprécient pas particulièrement, pour ne pas dire qu'ils se détestent cordialement. Mais ils doivent courageusement faire face à leurs responsabilités individuelles, l'un ayant un pays à gérer dans toute sa complexité et l'autre étant soucieux d'indicateurs fixés à l’avance pour piloter une monnaie avec une extrême prudence afin ne pas plonger l'économie nationale dans le chaos.
Nos chef d'Etats sous le FCFA ne rencontrent pratiquement jamais le gouverneur de la banque centrale autrement que lors de cérémonies protocolaires. Mais dans un système de monnaie nationale les deux personnages sont constamment en train de s'engueuler au téléphone et on ne compte pas les sorties précipitées du banquier pour des rendez-vous "urgents" à la présidence.
DE L’ART DE GOUVERNER LA BANQUE CENTRALE
Dans son excellent ouvrage intitulé « Monnaie, servitude et liberté », l’économiste camerounais Dr Joseph Tchundjang Pouemi rapporte ce propos d’un responsable de la monnaie aux Etats-Unis : « L’art de la Banque centrale est devenu, à mon avis, l’une des pierres angulaires de l’édifice de notre civilisation».
Je rapporte ces larges extraits de l’ouvrage de Dr Pouemi sur la monnaie :
« Il convient qu’en Afrique la monnaie cesse d’être le territoire du tout petit nombre de « spécialistes » qui jouent aux magiciens, car, me disait un jour mon maître Maurice Allais, « rien n’est plus urgent que d’informer l’opinion publique et de rappeler aux gouvernements l’importance de la monnaie ».
« L’Afrique a produit des poètes, des savants dans tous les domaines, des médecins et des ingénieurs de réputation mondiale, des hommes politiques et des diplomates redoutés. Tous ont pu se faire comprendre jusque dans les villages les plus reculés. Elle n’a pas réussi à avoir des comptables et des licenciés en droit pour gérer ses banques, et d’abord ses banques centrales. Le contrôle de sa monnaie lui échappe, à des degrés divers, il est vrai, selon les héritages coloniaux, le sens de la chose publique et de l’honneur, mais partout douloureusement.
« Pourtant, s’il y a un domaine qui aurait dû retenir l’attention de l’Afrique au lendemain de l’indépendance, c’est bien celui de la monnaie, car, c’est à peu près unanimement admis maintenant par les économistes, elle occupe une position centrale dans la vie sociale. C'est encore feu le Pr Rueff qui n’hésitait pas à la placer au cœur de l’ordre social. Et il en a toujours été ainsi : il n'y a pas, dans l’histoire connue de l'humanité, de changement décisif, quel qu’en soit le sens, auquel n’aient été associés d’une manière ou d’une autre des événements monétaires.
« Les civilisations antiques sont nées autour des cités. Ces cités n'ont vu le jour que lorsque la monnaie est apparue pour permettre les échanges…
« Sans le Shat, unité de monnaie égyptienne, il n'y aurait pas eu d’Egypte. L’Empire romain s’est formé et consolidé avec une monnaie forte et stable, il s’est décomposé avec une monnaie dépréciée. Le Moyen Age n’est qu’une juxtaposition de petits féodaux battant chacun la monnaie de son fief. L’Etat est faible. L’Eglise, seule autorité acceptée par tous, est forte. La Renaissance n’aura lieu que parce que le métal, l’or en particulier, sera une monnaie universelle, suffisamment abondante pour nourrir le commerce international, le roi aura assez d’autorité pour que seul son sceau confère de la valeur aux pièces…
« La force de la Banque centrale est donc redoutable. Ce n’est pas par le simple hasard des mots que son responsable suprême porte le titre de gouverneur : il détient, à lui tout seul, plus de pouvoirs que le gouvernement issu des élections générales.
« La stabilité des prix et la croissance économique deviennent ainsi des objectifs contradictoires, susceptibles de dégénérer en conflits entre le gouvernement et le gouverneur.
« Les sources de conflit sont encore plus nettes quand on ouvre l’économie sur l’extérieur. La hausse des prix entame la compétitivité de l’économie, tandis que les dépenses de l’Etat rongent les réserves extérieures que les banques centrales se croient obligées de maintenir à un niveau élevé. La croissance dans la stabilité des prix et l’équilibre extérieur sont des objectifs parfois inconciliables et demandent un dosage minutieux.
« La solution d’une banque centrale sous contrôle gouvernemental à cent pour cent est donc à écarter. Elle l’est d’autant plus que le gouvernement, transitoire par nature, tend à percevoir la vie économique en fonction des échéances électorales, alors que la Banque centrale, au cœur même de cette vie, doit avoir une vue plus lointaine.
« Il semble plus raisonnable de laisser au gouverneur de la Banque centrale une relative indépendance, sans laquelle il ne peut exercer efficacement ses fonctions quotidiennes, au jour le jour, et parfois heure par heure. Une indépendance qui le garde cependant sous l’autorité du gouvernement, mais lui reconnaisse le droit de porter les litiges devant l’opinion publique et, éventuellement, de dégager sa responsabilité en démissionnant.
Un gouverneur de banque centrale est bien trop puissant pour qu’il soit indépendant du gouvernement. Et Dr Pouemi de conclure : « En somme, une indépendance au sein du gouvernement et non à l’égard du gouvernement. »
Je ne vois pas comment nos trois présidents de l’AES pourraient en même temps jouer la complicité avec un seul gouverneur de banque centrale, chacun avec ses problèmes et ses quotidiennes sollicitations, pour faire jouer à une monnaie commune ses fonctions formelles et informelles, transparentes et opaques, orthodoxes et peu orthodoxes au gré des problématiques complexes de la gestion d’un Etat. A moins de reproduire une banque centrale à l’image de celle du FCFA, sur laquelle les gouvernements n’ont aucune prise. Que non !
Encore une fois, ceux qui parlent d’une monnaie commune dans l’AES ne savent pas de quoi ils parlent. Je recommande à tous la lecture de l’ouvrage de Dr Pouemi. Il n’y a jamais rien eu d’aussi pertinent et clair sur la monnaie.
LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE, PRINCIPALE MISSION D’UNE MONNAIE NATIONALE
Après la monnaie qui la finance, l'agriculture est la seconde source de création de richesse. Son flux de richesse est sans limite, renouvelable à souhait avec une, deux, trois à quatre récoltes annuelles et des productions illimitées sous serres. L’agriculture nourrit le bétail et fournit des bases au secteur agroalimentaire. Elle est un outil puissant de sécurité nationale, de souveraineté et d’influence sur la scène internationale.
Aussi, la monnaie n’a-t-elle point de mission supérieure à celle de promotion de l’agriculture. Un pays ayant sa monnaie nationale et qui n’a pas pu développer son agriculture doit son échec à l’inefficacité de sa politique monétaire. Un pays qui n’a pas sa monnaie et qui prétend développer son agriculture sur la base de micro-projets dispersés, financés au goutte-à-goutte par ses maigres recettes fiscales et la dette extérieure, n’est pas près de développer son agriculture.
Nous avions vu dans l’article précédent comment le dispositif financier national doit se structurer d’abord pour ne pas isoler la banque centrale des besoins en financement de l’économie et ensuite pour fluidifier la distribution de crédit. En l’occurrence nous avions situé la banque centrale au centre, en l’entourant de banques commerciales publiques qui seront alignées à la politique monétaire globale du pays. Et parmi ces banques commerciales publiques, celle de soutien au secteur agricole ont pour mission de financer l’agriculture. Et pour jouer la proximité avec les producteurs, les banques agricoles doivent se créer et se déployer au niveau départemental pour avoir des déclinaisons dans les communes. Chaque département du pays doit avoir sa banque agricole dont les interventions se feront dans les strictes limites de l’entité administrative, ceci pour être au plus près des producteurs pour interagir au quotidien avec eux dans la satisfaction de leurs besoins en financement. Inutile de dire que les producteurs prendront sur leur honneur de faire vivre une pareille institution créées pour les enrichir.
Ceci dit, les banques agricoles répercutent à la banque centrale les besoins de crédit des producteurs à toutes les étapes de la production agricole, notamment :
- Le conseil agricole ;
- Les salaires d’ouvriers pour la préparation des sols, les semis et le traitement des cultures ;
- L’achat d’intrants (semences et fertilisants) ;
- La location de machines agricoles (tracteurs et récolteuses) ;
- La logistique agricole (transports d’intrants, de machines, de récoltes) ;
- Les traitements post-récoltes (séchage par fours, battage, blanchissage, décorticage, égrenage, stockage, etc.).
Si le producteur est dans un mode d’exploitation plus structuré, le crédit sera orienté vers la construction d’infrastructures (aménagement de terres, construction d’une ferme, production d’eau et d’énergie, etc.). Qu’il s’agisse de ce qui se nomme « crédit de campagne » ou crédit tout court, le producteur dans ce système, n’a d’apport à faire que sa terre. Et c’est largement suffisant dans un système efficace.
Le crédit agricole, pour être qualifié comme tel, doit dimensionner ses interventions à la nature même de l’activité de production agricole. Dans cette optique, la problématique principale est le taux d’intérêt qui pose un double problème d’éthique. S’il rebute la religion, ce qui est une entrave à la vulgarisation du crédit dans certains milieux, il est en outre inadapté à l’agriculture. Je veux dire par là qu’un taux d’intérêt qui s’applique sur l’encours de crédit pendant des mois et des mois ne correspond pas aux besoins d’un producteur qui doit vendre une seule fois et recommencer à produire avec un nouvel emprunt.
Le crédit de campagne doit s’adapter à ce modèle d’affaire et seules des banques de l’Etat pourraient opérer cette adaptation cardinale.
Ensuite, si le producteur n’aime pas prendre un crédit qu’il doit rembourser avec en sus un taux usuraire, pourquoi ne pas lui offrir un produit financier conforme à sa volonté ? Des banques de l’Etat sont-elles obligées de prélever de l’intérêt sur de l’argent qui vient de l’imprimerie d’à côté ? Après tout, c’est un bien vide que le producteur remplit par son travail en lui donnant comme contenu du mil, de l’arachide ou du blé. Qui doit donc payer de l’intérêt à qui dans ce schéma, entre celui qui tend du papier imprimé et celui qui le transforme comme par miracle en denrées agricoles vendables localement et exportables sur les marchés internationaux contre des devises sonnantes et trébuchantes ?
La question revêt en outre une dimension morale. Pourquoi le banquier demandera-t-il des « garanties » d’immeubles pour remettre au producteur du papier imprimé qu’il a demandé auprès de la banque centrale ? Il répondra peut-être qu’il aura emprunté cet argent auprès de la banque centrale, avec un taux usuraire. Eh bien, puisque tout vient de la banque centrale qui elle-même appartient à l’Etat, pourquoi doit-elle réclamer des intérêts et susciter des garanties en aval, alors qu’elle ne fait qu’imprimer et distribuer du papier.
On le comprend, la monnaie doit et peut être ce que l’on voudrait qu’elle soit. Telle que nous la connaissons dans le système FCFA, elle appartient à un banquier privé qui dicte ses règles pour s’enrichir davantage et enrichir et appauvrir qui il veut avec. Débarrassons-nous-en et fondons notre monnaie sur la base des valeurs et objectifs que nous lui assignerons souverainement.
Il faut donc enlever les œillères qu’on a posées sur nos têtes. Le crédit peut se promouvoir sans taux usuraire et sans garantie pour enrichir et sécuriser l’argent d’un prêteur privé. Son objectif étant de stimuler la production, on perçoit tout de suite que le taux d’intérêt et les garanties n’ont aucun rôle dans la production et qu’au contraire l’un la rend moins compétitive et l’autre complique l’accès au crédit.
Considérons que cet argent appartient à l’Etat et que le producteur ne peut utiliser la somme qu’on lui a prêtée que pour les missions spécifiées de la production agricole. Considérons de ce fait qu’il recevra des intrants et non de l’argent en numéraires, des machines à louer et non de l’argent, des ouvriers agricoles payés aux guichets de la banque, et que tous les fournisseurs se feront payer à la banque sur factures, sur le prêt que le producteur aura contracté, etc., et ainsi nous survolons tous les sophismes et épouvantails du système libéral qui voudrait faire croire que l’argent et le crédit sont des mystères entourés de religiosité et de mystique.
Nous aurons compris l’importance du dispositif qui doit entourer et accompagner le crédit en général et le crédit agricole en particulier. Un Etat ambitieux qui imprime du papier sous forme d’argent n’a pas à exiger de ses citoyens des intérêts et des garanties pour accéder au crédit.
Je m’explique.
Au plan moral et politique le principal « intérêt » de l’Etat est de voir la production agricole se développer pour enrichir les producteurs, créer des emplois, sécuriser le pays au plan alimentaire et jeter des passerelles fonctionnelles vers l’industrie en lui demandant des intrants et en lui fournissant des matières premières.
Au plan financier « l’intérêt » de l’Etat se situe dans la contribution en termes de recettes fiscales sur les activités de production agricole, d’exportation pour percevoir des devises et de transformation pour augmenter la valeur. Il est en effet évident que les intérêts que les banquiers perçoivent sur le crédit ne fait pas le millième des recettes que l’Etat pourrait lever sur les chaines de valeur agricoles.
Ceci dit, la production agricole est un secteur à risque pour des prêteurs privés et on comprend leur manque d’ardeur à prêter au secteur agricole. Une campagne agricole peut devenir un cauchemar par manque de pluie et par l’invasion d’ennemis des cultures, entre autres aléas.
Mais quand le producteur n’aura reçu que du papier imprimé, où se trouve le besoin de garantie pour son prêt ?
Enlevons donc définitivement de nos têtes ces concepts que nous avons fini par élever au rang de vérités indiscutables, parce que nous les avons appris à l’université, parce que nous vivons de leur système et patati et patata. Tout cela fut enseigné à dessein et imposé à l’humanité. Il y a bien une façon de voir la monnaie et le crédit pour un pays souverain.
On trouve d’ailleurs la limite de ces concepts libéraux dans les politiques de subvention des grands Etats à leur agriculture. Sans exception, tous les grands pays industrialisés subventionnent leur agriculture, qui pour alléger des charges de production, qui pour accéder à des marchés d’exportation, etc. Et justement les problèmes n’ont commencé pour l’agriculture européenne que quand l’Euro a vu le jour, par le truchement d’élites gouvernantes corrompues qui ont légué la souveraineté monétaire de leurs pays aux Rothschild. Il est en effet curieux de voir que seule l’agriculture européenne connait ces scènes de déversement de lait et de lisier devant les mairies dépourvues de solutions à leurs problèmes, ces longues et bruyantes caravanes de tracteurs sur des dizaines de kilomètres pour bloquer les autoroutes afin d’exprimer des mécontentements. C’est qu’en vérité les Etats européens ne peuvent plus subventionner leur agriculture, la pratique se faisant auparavant par la monnaie nationale vide issue des imprimeries. Depuis l’avènement de l’Euro qui ne leur appartient plus, les gouvernements doivent prêter auprès des banques privées des Rothschild et alliés. Et s’ils doivent le faire ils sont tenus de rembourser. Et en subventionnant ils ne peuvent espérer un retour de l’argent. C’est aussi simple !
L’agriculture européenne est programmée pour mourir. Les monnaies nationales souveraines qui la soutenaient par le crédit abondant et les subventions à tours de bras n’existent plus. Peut-être que la disparition de l’Euro qui est inéluctable, permettra de lui redonner des couleurs. Les peuples se réveillent partout.
EMERGENCE D’UNE CLASSE MOYENNE RURALE, INDICATEUR CLE D’UNE MONNAIE NATIONALE EFFICACE
Nous venons de voir que le crédit agricole universel est possible et qu’il n’y a qu’une monnaie nationale souveraine pour le réaliser. Dans un tel système, la magie de transformation sociale se trouve dans le fait que la production de richesse ne sera plus l’apanage des villes. Elle s’installera au cœur des campagnes, les producteurs ayant accès au crédit pour produire, vendre et améliorer leurs conditions de vie.
Imaginons en effet un producteur qui, sur la base de son seul actif de terrain, peut mettre en branle tout le dispositif financier et technique national pour produire et vendre, en marchant juste quelques kilomètres pour aller à la commune où se trouve le guichet d’une banque agricole. Par le crédit il produira, vendra, satisfera ses besoins, accumulera et participera par l’épargne à la formation d’un capital national qui sera utile pour les autres secteurs économiques.
Ce producteur aura-t-il besoin de migrer vers les villes et les autres pays ? Non ! Il créé sur place chez lui de la richesse et en profite. Il améliore sa vie, s’équipe, s’éduque et se soigne, marie ses enfants, prend de nouvelles épouses comme mes cousins Gobirawa et améliore son habitat. Nous sommes en plein dans l’émergence d’une classe moyenne rurale, objectif ultime d’une monnaie nationale.
Le Maroc qui a déjà 180 mille entreprises agricoles vise l’émergence d’une classe moyenne rurale dans la prochaine décennie. Dans nos pays de l’AES, j’estime que chaque pays peut modestement prétendre à 200 mille entreprises agricoles, au vu du grand potentiel dans chacun des pays.
REPENSER LA BANQUE ET LE CREDIT
Une monnaie nationale qui se veut efficace doit repenser profondément la banque et le crédit. Ce que nous vivons dans cette activité est un système pensé par certains milieux pour dominer l’humanité. Leur éthique et leurs principes de gestion n’ont rien d’universel. Le taux directeur ne doit plus être l’indicateur pour estimer la demande de crédit dans nos économies financièrement anémiées depuis des décennies. Les normes prudentielles de Bâle (peut-être du dieu Baal) pour gérer la banque doivent être réformées.
Nous ne découvrirons pas les recettes de la réforme monétaire dans des livres ou dans des cours à l’université. L’école est faite pour nous emprisonner et non pour nous libérer. Il s’agit pour une fois de réfléchir ensemble, en mettant à contribution les expériences, en se réinventant et en se surpassant pour être à la hauteur des espérances de nos peuples à goûter enfin au bien-être.
On comprend que dans un système monétaire souverain, la banque centrale est le principal acteur de l’investissement structurant via le trésor public à qui elle donne de la monnaie, sans obligation pour elle de la rendre. Les banques d’investissement dans ce contexte, doivent appuyer des segments de la demande de crédit, notamment en concédant des prêts concessionnels pour importer des biens industriels.
MON MESSAGE A NOS ECONOMISTES ET A NOS DIRIGEANT DE L’AES
Les moments que nous vivons dans l’AES sont historiques. Pas besoin d’en faire un développement. Nos dirigeants ont libéré les pays de la servitude politique et de l’occupation militaire. C’est ce qu’on attend de fiers et patriotes militaires. Mais le reste du combat libérateur appartient aux économistes qui doivent déconstruire le système de servitude monétaire et de destruction du développement dans lequel nos pays sont entretenus depuis des décennies.
A l’étape actuelle nous avons juste montré au système dominant que nous pourrions nous libérer. Le chemin de la liberté reste long tant que notre système économique travaille encore pour l’ennemi, à travers le FCFA et les actifs miniers qui sont largement dans les mains des firmes du portefeuille de Blackrock et Avangard.
Il reste en effet à emprunter le pas le plus décisif vers notre liberté qui est la sortie du FFCFA et la promotion de trois monnaies nationales souveraines qui transformeront nos pauvres paysans en entrepreneurs riches et fiers de leurs élites. Mais c’est véritablement à ce moment que nos problèmes vont commencer car nous aurons déclaré la guerre aux banquiers internationaux. Mais assumons-nous, car la liberté a un prix.
Il appartient à nos économistes de déconstruire les théories asservissantes qu’ils enseignent dans nos universités. Il leur appartient de donner le bon conseil à nos dirigeants pour leur faire franchir le pas décisif vers la sortie du FCFA. Que les peurs distillées sur les plateaux des télévisions cessent donc.
IL N’Y A AUCUN PREALABLE D’INDUSTRIE, D’AGRICULTURE OU DE « CRITERES DE CONVERGENCE » POUR LANCER UNE MONNAIE NATIONALE. IL S’AGIT JUSTE DE SIGNER UN DECRET.
Par Ali ZADA
Expert en politiques ;
Enseignant à Swiss Umef University de Niamey.

